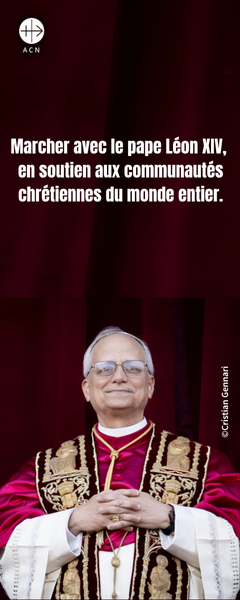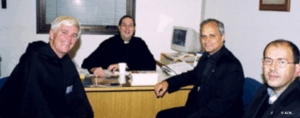Mgr Papias Musengamana, évêque du diocèse de Byumba au nord-ouest du Rwanda, a récemment visité le siège international de l’Aide à l’Église en Détresse (AED). Dans un entretien, il explique à l’œuvre pontificale comment son diocèse a su se relever de l’absence quasi totale de prêtres après le génocide de 1994 et parle de l’importante de la pastorale familiale et de la jeunesse. (Photo de couverture : Notre-Dame de Kibeho, aussi nommée Mère du Verbe).

L’année dernière, l’Église au Rwanda a ouvert les festivités d’un double jubilé de
deux ans : les 125 ans de l’évangélisation du pays et le Jubilé de l’Espérance. Pouvez-vous nous parler de la situation des catholiques dans le pays ?
Nous représentons environ 39 % de la population du pays. Le nombre de catholiques a baissé ces dernières années. Les sectes se sont multipliées. L’évangélisation reste donc une priorité. Un défi pour nous est le manquement de moyens financiers, d’infrastructures. Mon diocèse est très rural, et les chrétiens à la campagne doivent parcourir de longues distances à pied pour aller à l’Église. Cela pose un problème pour les personnes âgées, par exemple.
Quel impact le génocide de 1994 a-t-il eu sur l’Église et les prêtres ?
La réconciliation au sein de la population et des familles après le génocide constitue un défi majeur pour que l’Évangile puisse prendre racine davantage. L’Église a commencé ce travail depuis longtemps, mais le chemin est encore long.
Pendant le génocide, de nombreux prêtres ont été tués ou ont fui. Dans mon diocèse, il n’en restait plus que trois ou quatre. Nous n’avions plus l’espoir d’avoir un jour à nouveau suffisamment de prêtres pour desservir les paroisses. Mais finalement, il y a eu beaucoup de jeunes hommes qui sont entrés au séminaire. Aujourd’hui, 30 ans plus tard, mon diocèse compte plus de 130 prêtres ! La majorité est assez jeune, car elle a été ordonnée après 1994.

C’est la raison pour laquelle la formation des prêtres est l’une des priorités de l’AED…
Oui, et je voudrais saisir l’occasion pour dire un grand merci pour le travail que l’AED fait grâce aux bienfaiteurs qui nous sont proches. L’année dernière, vous nous avez apporté une aide précieuse pour la formation de 59 séminaristes et pour la rénovation des installations sanitaires du petit séminaire. Cette année, vous soutenez la formation de 65 séminaristes. Merci également pour l’appui des différents projets pastoraux pour l’évangélisation de notre peuple.
Quels facteurs identifiez-vous pour le grand nombre de vocations chez vous ?
Les petits séminaires sont très importants pour nous : c’est là que naissent de nombreuses vocations. Chaque année, on a une dizaine de jeunes du petit séminaire qui continuent au grand séminaire.

L’impact que la famille a sur les enfants est également essentiel. On observe, par exemple, qu’un très grand nombre de prêtres, de religieux et de religieuses proviennent de familles où au moins un parent a été catéchiste. Les catéchistes sont des personnes très dévouées, profondément enracinées dans la foi. Ce sont eux, les premiers évangélisateurs du pays. Et donc, cette foi, ils la transmettent aussi à leurs enfants.
En conséquence, la pastorale de la famille est si importante !
Effectivement. Elle a une grande place chez nous, même si, malheureusement, nous n’avons pas beaucoup de moyens. Mais les familles sont confrontées à beaucoup de défis et l’Église doit les aider. Le monde est devenu comme un village. L’influence de l’extérieur est très forte à cause de l’internet, les réseaux sociaux, la télé. Nous ne sommes pas à l’abri des idéologies. On constate beaucoup plus d’individualisme, de matérialisme — les couples se disputent à cause de l’argent. Nous avons de nombreux divorces, même dans les villages de campagne. L’évolution a été très rapide. En dix ans, les choses ont beaucoup changé.

Pour les jeunes, il est important d’avoir des modèles à suivre. Vous êtes également responsable de la pastorale des jeunes au sein de la conférence épiscopale rwandaise. Existe-t-il de tels modèles au Rwanda — par exemple des saints qui ont déjà été canonisés ?
Pas encore, mais il y a un couple qui est en procès de béatification : Cyprien et Daphrose Rugamba. Ils ont été assassinés avec plusieurs de leurs enfants lors du génocide. Leur parcours conjugal n’a pas été facile, mais leur témoignage est d’autant plus beau. Le couple avait aussi un grand amour pour l’Eucharistie. Aujourd’hui, de nombreux jeunes vont encore à la Messe, mais ils sont de moins en moins nombreux. Nous espérons pouvoir organiser des camps avec eux pendant les vacances pour les réunir, leur faire de la catéchèse, les sensibiliser à des dangers comme la toxicomanie, etc. En effet, durant ces trois mois d’été, sans occupation, beaucoup se retrouvent livrés à eux-mêmes : ils passent leurs journées dans la rue et y entrent en contact avec les drogues. Or, si nous perdons les jeunes, nous perdons la société. Les serviteurs de Dieu, Cyprien et Daphrose, qui étaient également très engagés auprès des enfants des rues, sont donc de précieux intercesseurs pour que nos jeunes trouvent le chemin vers le ciel.