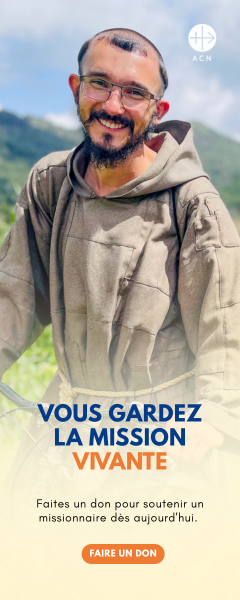Lors de sa récente visite au siège international de l’œuvre de charité internationale Aide à l’Église en Détresse (AED) en Allemagne, le cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, s’est entretenu avec l’organisme. Dans l’entrevue suivante, le cardinal témoigne de l’action décisive menée par des chefs religieux pour éviter que les conflits qui agitent le pays ne tournent à l’affrontement confessionnel.

Pourriez-vous nous présenter le contexte dans lequel vit votre pays ? Pourquoi votre pays ne connait-il pas la paix ?
En 2020, le président Faustin-Archange Touadéra a été réélu, dans des circonstances périlleuses. L’ancien président avait des troupes, et menaçait de revenir au pouvoir au moyen d’un coup d’État. Monsieur Touadéra a fait appel au Rwanda et à la Russie pour obtenir des alliances extérieures, afin de chasser les rebelles de son pays. Le groupe Wagner en particulier a affronté les rebelles et les a chassés de toutes les grandes villes.
Mais les rebelles sont encore bien présents dans les villes plus petites et ils entretiennent l’insécurité. Ils empêchent les mouvements de la population, qui redoute les barrages de routes ou les engins explosifs. L’une de ces mines a récemment explosé au passage du véhicule du père Norberto Pozzi. Ce missionnaire italien a dû être amputé du pied, alors qu’il est bien évident qu’il n’a rien à voir avec le conflit politique en cours…
Comment expliquez-vous la persistance de la violence dans votre pays ?
Notre pays est plus grand que la France. Il est difficile à contrôler pour une administration déjà fragilisée. Il n’y a pas vraiment de frontières et les milices hostiles au gouvernement sont réparties sur l’ensemble du pays, insaisissables. Les motivations politiques de ces hommes m’apparaissent floues. Je crains que ces gens qui se sont faits miliciens ne puissent plus à présent se passer de leurs armes, car elles sont devenues leurs gagne-pains. Ceux qui appartiennent à des groupes structurés s’approprient des portions du territoire qu’ils pillent. Naturellement, ils sont là où il y a des richesses, comme des bois et minéraux précieux. L’État de droit peine à revenir, et tous nos concitoyens en pâtissent.

À l’origine de la guerre centrafricaine, on parlait du mouvement des Sélékas, essentiellement musulman, qui s’en prenait aux chrétiens. Le conflit a-t-il une dimension religieuse ?
Avec les autres chefs religieux du pays, les pasteurs et les imams, nous clamons haut et fort que ce conflit n’est pas religieux. Nous avons toujours montré un front uni devant le risque de confessionnalisation de cette guerre, et cela a porté ses fruits. Nous autres, chefs religieux, sommes comme les parents dans une famille ; nous devons montrer l’exemple. Je crois que nos concitoyens ont vu que nos relations amicales n’ont jamais cessé, que nous avons toujours clamé que nos divisions nous étaient imposées de l’extérieur. Nous avons été aidés dans cette œuvre de paix par la structure de la société centrafricaine, où beaucoup de familles sont mélangées, où chacun connait une cousine, un oncle ou un autre parent qui appartient à une autre religion, mais qui partage le même arbre généalogique. Nous avons assisté à de magnifiques mouvements de fraternité à Bangui, où de jeunes musulmans aidaient à reconstruire des églises et où de jeunes chrétiens aidaient à reconstruire des mosquées. En fin de compte, aussi terrible que cette crise soit, elle a eu un effet bénéfique en nous rapprochant.

Mais lorsque l’on voit tant de pays sur la bande sahélienne devenir le théâtre de conflits entre chrétiens et musulmans, par exemple au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria, au Niger, ne peut-on pas craindre une contagion ?
Notre expérience prouve que le conflit religieux n’est pas une fatalité. Il existe des contre-exemples comme le Sénégal, où les musulmans sont largement majoritaires, mais où il n’y a pas de conflit interreligieux. Il est même arrivé que des présidents chrétiens soient élus. Je crois que pour éviter une division religieuse, les chefs religieux ont un rôle de toute première importance à jouer.
Bien que votre Église vive dans un pays qui traverse une terrible crise, elle montre aussi une vitalité extraordinaire, qui se traduit en particulier par le nombre de vocations sacerdotales. Y voyez-vous un paradoxe ?
Je crois au contraire que cette période de crise est favorable à la croissance de l’Église. Pour mes pauvres concitoyens qui connaissent les deuils, l’insécurité et la pauvreté, Dieu est vraiment le rocher sur lequel ils peuvent s’appuyer. Pendant les troubles, durant lesquels tant de gens ont été déplacés, beaucoup ont trouvé refuge dans nos églises et certains enfants y sont même nés.
Notre Église catholique centrafricaine cherche maintenant à être présente dans les périphéries, comme dans le diocèse de Bossangoa, au nord-ouest, qui a été martyrisé par les groupes armés. Nous y avons une école, et nous préparons de jeunes prêtres humainement et spirituellement, à se rendre dans cette zone à risque. Nous lançons aussi un appel à des couples de laïcs catholiques pour qu’ils se rendent là où personne ne veut aller.

Cela ne représente-t-il pas un danger trop grand ?
Les gens qui résident dans ces régions difficiles ont besoin des sacrements, du témoignage de la fraternité de l’Église universelle. C’est un enjeu important. Quand j’ai été nommé cardinal, on m’a bien dit, avec raison, que j’étais cardinal pour tout le pays et pas seulement pour Bangui. Je me rends donc dans des régions où les hauts représentants du gouvernement ne peuvent pas aller. Évidemment, cela comporte des risques, à commencer par ceux induits par l’état de nos routes. Certaines n’ont pas été refaites depuis l’Indépendance ! Dernièrement, mon véhicule s’est retourné sur l’une d’elles… Mais notre vie est petite par rapport aux attentes des personnes qui ont besoin de secours spirituels.
Reste-t-il une trace du passage du pape François en 2015 ?
Oui, et là aussi la cohésion interreligieuse s’en est trouvé renforcée. C’était un voyage à haut risque, mais le pape a été accueilli par tout le peuple. Dans le stade, il y avait des catholiques, des protestants et des musulmans. L’un de ces derniers m’a même dit que le pape était venu les libérer eux les musulmans ! Il appartenait à une communauté cloîtrée dans le quartier appelé « Kilomètre 5 », qui vivait dans la peur de représailles des chrétiens.
L’année 2015 était le Jubilé de la Miséricorde et le pape a ouvert une Porte Sainte ici, un geste qui restera dans l’histoire du pays. En principe, il n’y en a pas d’autres en dehors de Rome. C’est une porte de la vie, du pardon, qui représente la réalité de la venue du successeur de Pierre dans notre pays.