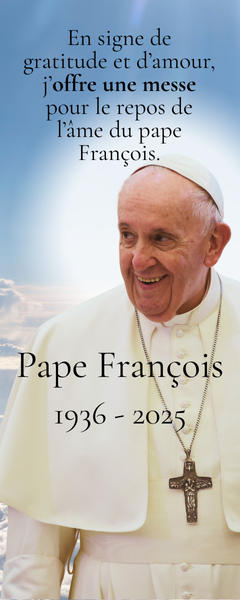Verónica Katz, responsable des projets de l’œuvre de charité internationale Aide à l’Église en Détresse (AED) pour les pays d’Amérique centrale, a visité les diocèses de la République dominicaine à la frontière avec Haïti en décembre 2024. Dans cet entretien, elle partage ses impressions et ses expériences dans la partie la moins visible du pays.

Quand les gens pensent à la République dominicaine, ils pensent à un « paradis. » Or, quelles expériences avez-vous faites dans les diocèses que vous avez visités ?
L’ouest de la République dominicaine est sans aucun doute une région magnifique, mais presque oubliée, avec de grands défis économiques, sociaux et pastoraux. Beaucoup de gens supposent que le pays tout entier ressemble à Punta Cana et à d’autres endroits plus touristiques, et qu’en tant que pays « développé », il n’a pas besoin d’aide. Les diocèses que nous avons visités – Barahona, San Juan de la Maguana et Mao-Montecristi – sont les plus grands du pays et couvrent les provinces les plus pauvres. Il s’agit d’une région plutôt négligée par le gouvernement. Plusieurs de ses paroisses ne sont pas autonomes, mais la foi et la solidarité des fidèles et de l’Église locale sont inspirantes. Les distances sont énormes et, dans les zones urbaines en pleine croissance, il n’y a pas assez de chapelles. De plus, l’ouest est très montagneux, ce qui rend le travail pastoral difficile en raison de l’absence de moyens de transport adéquats.

Ces diocèses, à la frontière avec Haïti, sont dans une situation très vulnérable. Outre leurs propres défis, ils sont également confrontés à la crise migratoire, qui s’est aggravée ces derniers temps, compte tenu de la situation dramatique dans le pays voisin.
Quel impact cette situation migratoire a-t-elle sur le pays et sur le travail de l’Église à la frontière ?
Il y a de nombreux points de contrôle militaires et, par conséquent, il n’est pas facile de se déplacer. On nous a souvent arrêtés pour voir si nous avions des Haïtiens en situation irrégulière dans la voiture. En fait, nous avons vu des camions avec des Haïtiens en train d’être déportés, des camions en très mauvais état. La plupart des expulsions ont lieu la nuit, mais on parvient aussi à les voir pendant la journée. Cela a des conséquences pour les diocèses frontaliers du pays; en outre, ils sont confrontés à des défis linguistiques, car de nombreux Haïtiens parlent seulement le français ou le créole haïtien (Kreyòl) et peu de catéchistes parlent les deux langues.

Quelle est la situation du clergé et des agents pastoraux dans ces diocèses ?
Le nombre insuffisant de prêtres contraint ceux qui sont là à gérer un trop grand nombre de paroisses et à assumer de multiples responsabilités diocésaines, dans un vaste territoire aux routes précaires. C’est très fatigant pour eux et ils ont l’impression de ne pas pouvoir accomplir toutes leurs tâches. On nous a même dit qu’il y a des missionnaires qui ne veulent pas être envoyés en mission dans cette région parce qu’elle est très difficile et dangereuse, et qu’ils sont peu aidés. Comme dans de nombreux pays d’Amérique centrale, des groupes sectaires sont en plein essor, et dans certaines régions, on commence également à trouver des rituels tels que la sorcellerie et le vaudou, qui ont été introduits par les immigrants d’Haïti ou par d’autres influences. Les responsables laïcs sont également très limités, car ils manquent souvent de ressources et de matériel. Pourtant, leur solidarité est impressionnante.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué pendant ce voyage ? Quels sont les signes d’espoir ou de force que vous avez vus dans ces communautés et qui pourraient inspirer d’autres personnes ?
La République dominicaine est un pays profondément catholique, très dévoué au Sacré-Cœur de Jésus. La Croix et les Saintes Écritures sont représentées sur les armoiries de l’État. J’ai pu constater que la foi catholique continue de jouer un rôle important, et cela m’a profondément impressionné.

Je voudrais également souligner ma visite au Batey 5, où l’AED apporte son aide depuis un certain temps déjà. La vie dans les bateyes (des campements où vivent les coupeurs de cannes) est très dure. Les gens n’ont pratiquement pas de ressources économiques et leur détresse est grande. Nous avons fait l’expérience d’une communauté très active, une église vraiment vivante. Et bien sûr, je ne peux pas oublier ce qu’un prêtre m’a dit lors de notre visite à Jimaní et qui m’a vraiment touché : la visite de l’AED leur a fait sentir qu’ils n’étaient pas oubliés. Rien que cette visite était un signe d’espoir pour eux.
Quels sont les principaux projets prévus par l’AED dans le pays pour 2025 ?
Cette année, l’AED continuera de renforcer son soutien dans le pays par la construction d’églises, de maisons paroissiales et d’autres espaces pastoraux, par le financement de moyens de transport pour atteindre les zones reculées, par l’aide financière à la formation des laïcs, des catéchistes et des séminaristes, par le soutien aux religieuses, par des investissements dans les médias et par des intentions de messe pour les prêtres.